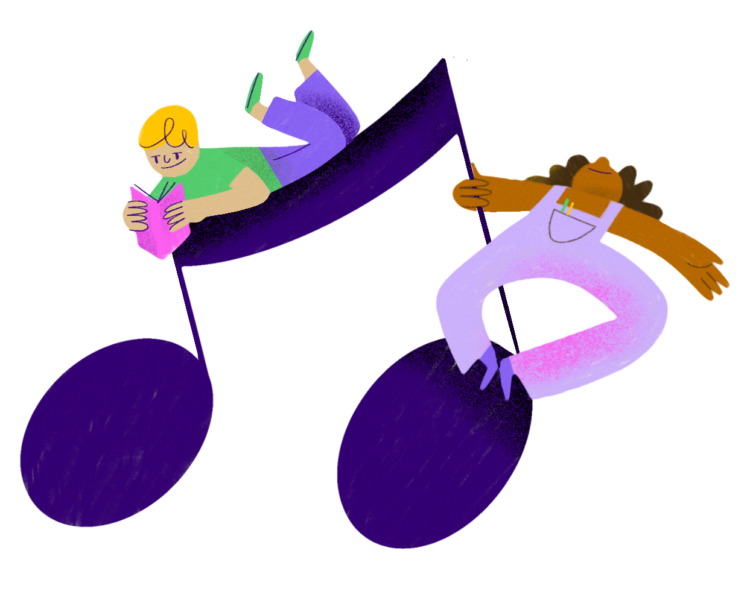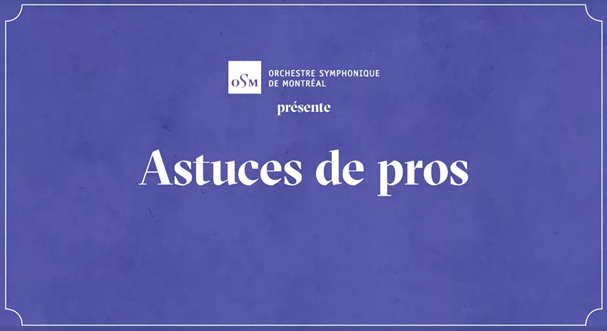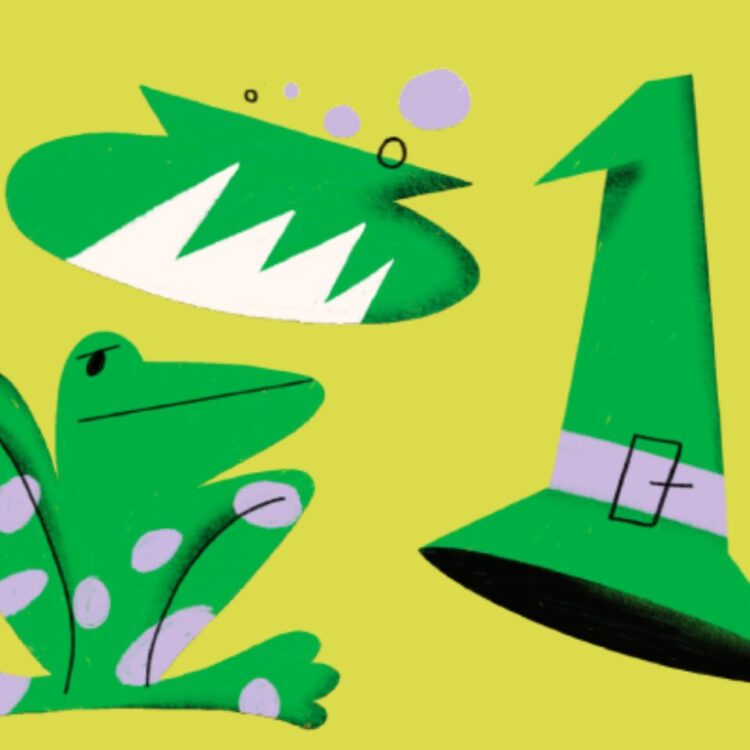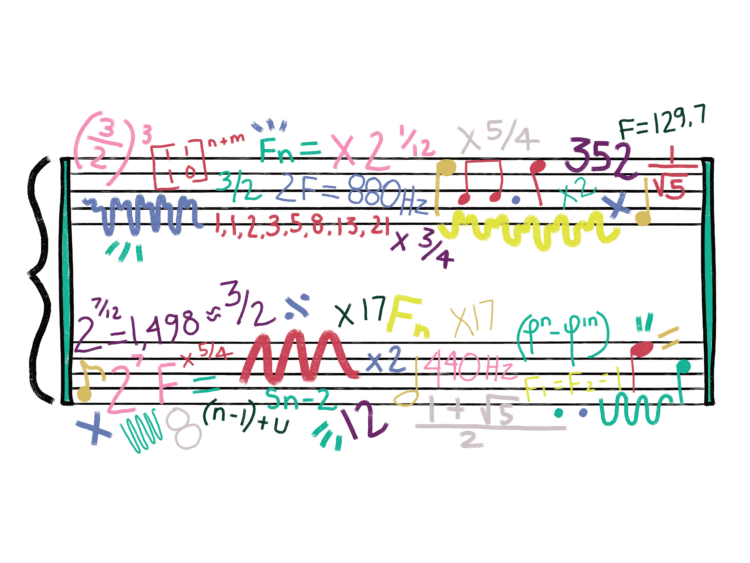Ressources pédagogiques
Enrichir les découvertes musicales des jeunes
Explorez les ressources pédagogiques créées par l'OSM pour les enseignants et les parents souhaitant enrichir les découvertes musicales de leurs enfants. Ces ressources peuvent être utilisées pour préparer une visite au concert, compléter l'enseignement musical en classe, ou simplement éveiller l'intérêt musical des élèves de manière ponctuelle.